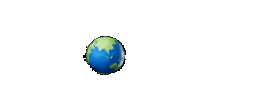Leurs noms étaient Hélène, Johanna, Simon, etc. : ce que des chrétiens néo-apostoliques d’origine juive de Stuttgart (Allemagne) ont vécu et souffert – voici une contribution à la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste du 27 janvier.
L’Avent 1941 commence dans le froid, prélude à un hiver glacial. Le lendemain, une jeune femme quitte le Killesberg à Stuttgart (Allemagne). Sur sa route, elle passe devant un cimetière. Après trois kilomètres, elle arrive à la gare de marchandises. Elle est infiniment seule. Pourtant, plus de mille personnes l’accompagnent.
La jeune femme s’appelle Helene Wöhr, elle est enseignante en maternelle et dispose de merveilleux témoignages : « Il y a dans sa nature une sorte de fraîcheur très affectueuse et joyeuse », peut-on lire. Elle a « beaucoup d’affection pour les enfants » et on ne « la laisse partir qu’à regret ». Mais maintenant, elle doit voyager.
Trois jours plus tôt, elle a fait ses adieux à ses parents, en larmes. À ce moment-là, tous ses biens avaient déjà été confisqués par la Gestapo. L’apôtre de district Georg Schall avait encore conseillé à Helene d’aller en Suisse. Mais elle est restée – « par amour et par inquiétude pour ses parents ».
Un voyage sans retour
Le « train de l’Avent » est un train de déportation. La destination est Riga, en Lettonie. Helene Wöhr a longtemps ignoré qu’elle était d’origine juive. Au départ, ses parents étaient protestants. En 1922, sa mère et son beau-père se sont convertis pour adhérer à l’Église néo-apostolique. Sa mère, Anna Wöhr, est une « demi-juive ». Helene elle-même a un père juif. Avec trois grands-parents de religion juive, elle est considérée comme « juive de race » selon le premier décret de la loi sur la citoyenneté du Reich de 1935.
Le voyage a duré trois jours et trois nuits. Dans le ghetto de Riga, on a « fait de la place », des milliers de juifs lettons ont été fusillés. Helene et ses compagnons d’infortune végètent dans des étables et des granges partiellement ouvertes, par un froid qui dépasse parfois les moins 30 degrés. Ils doivent travailler dur. Il n’y a presque rien à manger. Sur les plus de mille « voyageurs », seules 43 personnes survivent à la guerre.
Le 30 avril 1942, Helene écrit une lettre à sa mère Anna, désormais elle aussi condamnée à mort : « si seulement c’était déjà terminé » – c’est son dernier signe de vie. Sa meilleure amie, Margot Neumeier, a raconté bien des années plus tard qu’elle avait souvent rêvé d’Helene. Ensuite, elle voyait toujours Helene dans une robe ornée de perles.
Elle n’était pas une exception
Le destin d’Helene Wöhr (1915-1942) n’était pas un cas isolé. Rien qu’à Stuttgart, au moins six chrétiens néo-apostoliques d’origine juive ont été déportés à l’époque nazie :
Fanny Perlen (1894-1941) était également dans le train de déportation vers la Lettonie et a été assassinée. Josefine Glück (1872-1943) a été envoyée à Theresienstadt (en tchèque, Terezín), où elle est décédée en raison des privations. Son fils Hermann Glück (1901-1969) était fonctionnaire à la Chambre de commerce et d’industrie. Malgré les meilleurs bulletins de notes, le « demi-juif » a été licencié. Il a survécu à sa période de travail forcé, gravement atteint dans sa santé.
Cecilie Sofie Barth (1873-1953), Johanna Dierheimer (1894-1971) et Simon Peritz (1884-1972) ont survécu à la Shoah parce qu’ils avaient vécu dans un « mariage mixte privilégié » et étaient mariés à des « aryens ». Malgré tout, eux aussi ont fini par être déportés.
Des cœurs aimants, des mains secourables
Et qu’a fait l’Église ? « Pendant toutes les années du régime national-socialiste, nous avons reçu, moi et ma famille […] tant d’amour, d’aide, de soutien en argent et en nourriture, de conseils et de réconfort de la part des membres et des personnalités dirigeantes de la communauté », a rapporté Hermann Glück le 2 mai 1945.
« Des personnes fidèles, en particulier le conducteur de communauté de l’Église néo-apostolique, nous ont tendu les mains avec amour et efficacité », a déclaré Simon Peritz le 20 juillet 1945. Sa femme a « également bénéficié d’un soutien financier », « en cette période de grande détresse » après sa déportation.
Johanna Dierheimer, gravement malade après son retour de Theresienstadt, a témoigné le 24 mai 1946 : « Ces messieurs les ecclésiastiques de la paroisse […] m’ont fait de riches dons d’argent, sans lesquels j’aurais péri avec mes enfants. »
Tant Johanna Dierheimer que Hermann Glück et Simon Peritz ont gardé un lien avec l’Église après la guerre.
Helene Wöhr s’est occupée des enfants de la famille Heydt dans l’un de ses derniers postes, de janvier 1938 à décembre 1940. Photo : Peter Heydt
À propos de l’auteur

Karl-Peter Krauss (né en 1955) est président du groupe de travail « Histoire des Églises néo-apostoliques ». Il a fait ses études à Tübingen et a obtenu son doctorat sur un sujet historico-géographique. Ses livres relatifs à l’histoire de l’Église sont très reconnus même parmi les critiques. Jusqu’à son admission à la retraite en 2021, il a été conducteur de communauté au sein de l’Église territoriale d’Allemagne méridionale.