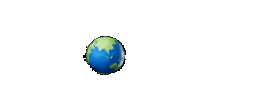Quand les décideurs doivent-ils s’abstenir ?

Que faire lorsque des membres de la direction de l’Église se trouvent en situation de conflit d’intérêts ? Le Conseil d’administration de l’Église néo-apostolique internationale (ÉNAI) s’est attaqué à ce sujet brûlant et a présenté des directives à ce sujet.
La question est développée sous le titre « bonne gouvernance ». Il s’agit des principes de gouvernance au sein de l’ÉNAI et des Églises territoriales. Il existe déjà des directives à ce sujet sous les mots clés Unité organisationnelle, Continuité, Prise de décision partagée, Prise de décision éclairée, Responsabilité, Comportement éthique, Devoir de diligence, Supervision, Transparence, Représentation et suppléance.
Dans le chapitre devoir de diligence, le point crucial actuel n’avait jusqu’à présent été qu’esquissé : « Les membres des organes de direction doivent éviter tout conflit d’intérêts », peut-on y lire. « Si des conflits d’intérêts surviennent, ils doivent être divulgués de manière transparente et le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts doit s’abstenir de voter ou de participer à la question concernée. »
L’ÉNAI vient de concrétiser ce qu’il faut entendre exactement par conflits d’intérêts.
Quand les intérêts entrent en conflit
Les organes de direction d’une Église territoriale comprennent généralement le président de l’Église, le Conseil d’administration et l’assemblée générale au sein de laquelle les membres sont représentés par des représentants. La composition exacte dépend de leurs propres statuts et des exigences légales, qui peuvent varier d’une région à l’autre.
La définition des conflits d’intérêts est désormais une nouveauté dans ces directives : « Dans le contexte des organes de direction, il y a conflit d’intérêts lorsqu’un membre de l’organe de direction a un intérêt personnel ou financier, direct ou indirect, qui pourrait influencer sa capacité à prendre des décisions impartiales dans le cadre de son rôle ou sa capacité à agir dans le meilleur intérêt de l’Église. »
Minimiser et documenter
Des exemples concrets de conflits d’intérêts sont également ajoutés dans les directives :
- Lorsque des mandats sont attribués à des entreprises dans lesquelles des décideurs ou des membres de leur famille détiennent des parts, exercent une influence, occupent des fonctions de direction ou sont employés.
- Lorsque des membres de la famille de décideurs sont recrutés pour un poste alors qu’il existe des candidats plus qualifiés.
- Lorsque des décideurs reçoivent des avantages personnels, tels que des remises, des cadeaux ou des participations aux bénéfices de la part d’un fournisseur ou d’un prestataire de services en particulier.
« Il est important d’identifier efficacement les conflits d’intérêts, de les minimiser lorsqu’ils ne peuvent être évités et de les gérer afin de maintenir l’intégrité et la confiance dans les organes de direction de l’Église », soulignent les nouvelles directives. « Dans l’idéal, la procédure appliquée dans un cas particulier est consignée dans les procès-verbaux des organes de direction. »
Le Conseil d’administration de l’ÉNAI a approuvé à l’unanimité ce complément et l’a transmis dans l’attente d’un retour aux autres apôtres de district.
Stratégiquement à l’œuvre
Les directives précédentes avaient été adoptées en 2023 au Cap (Afrique du Sud). Ensuite, les Églises territoriales se sont examinées elles-mêmes sur la base de ce catalogue. Le résultat : aucune déficience systémique grave n’a été constatée à ce jour. Les besoins d’optimisation existants doivent être abordés. Et l’autocontrôle est entré dans une deuxième phase.
L’ÉNAI a commencé à prendre des mesures en ce sens dans sa propre maison. Ainsi, les statuts les plus récents ont limité le pouvoir de décision de l’apôtre-patriarche pour les questions financières et transféré la responsabilité allant au-delà au conseil d’administration nouvellement créé en tant qu’organe collégial.
Avec le thème de la « bonne gouvernance », l’Église néo-apostolique poursuit son travail de stratégie ecclésiale autour de standards internationaux. Ces dernières années, il s’agissait notamment d’exigences minimales pour le fonctionnement d’une communauté ainsi que de l’évaluation globale des risques pour l’existence des Églises territoriales.
Ph oto: KENZOGROW – stock.adobe.com