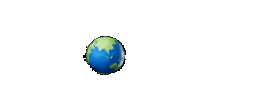Service divin en faveur des défunts : pour les chrétiens néo-apostoliques, il s’agit généralement d’une affaire très personnelle et pleine d’émotion. Mais tout cela a une bonne raison – questions et réponses relatives à la doctrine.
Les services divins en faveur des défunts ont lieu le premier dimanche des mois de mars, juillet et novembre. Outre la commémoration, la prière et l’intercession, l’administration des sacrements en fait également partie. Lors des services divins célébrés par l’apôtre-patriarche et les apôtres de district, deux ministres reçoivent, en lieu et place des défunts, le saint baptême d’eau, le saint-scellé et la sainte cène.
Cependant : y a-t-il vraiment une vie après la mort ?
La croyance en l’immortalité de l’âme ne se trouve qu’en filigrane dans la Bible. Cela se développe depuis l’Ancien Testament jusqu’au Nouveau Testament, en passant par ses écrits tardifs (« Apocryphes »). Ce n’est qu’à l’époque néo-testamentaire que les idées grecques et juives se fondent en une coexistence chrétienne. La personnalité est conservée, l’état d’âme dépend de leur proximité ou de leur éloignement de Dieu.
L’état des âmes peut-il néanmoins encore changer ?
C’est ce que professe la majorité des chrétiens : le catholicisme et l’orthodoxie enseignent tous deux qu’il peut y avoir une évolution dans l’au-delà. Le protestantisme voit les choses différemment : le Père de l’Église Luther parle du sommeil de l’âme. La théorie actuelle de la mort totale repose sur l’anéantissement de l’individu et sa recréation lors de la résurrection.
L’univers des défunts peut-il être justifié d’un point de vue biblique ?
La transmission du salut aux défunts se rattache à l’Écriture sainte de trois manières :
- la volonté salvatrice universelle de Dieu : Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Jésus-Christ est maître sur les vivants et les morts.
- la descente de Jésus dans le séjour des morts pour la transmission du salut. Cette idée se retrouve également dans le Symbole des Apôtres, l’une des principales confessions de foi transcendant les confessions.
- le baptême par procuration à Corinthe : c’est là que certains se faisaient baptiser à la place de leurs proches décédés. L’apôtre Paul mentionne cette pratique sans la critiquer, comme il le fait dans d’autres cas.
Pourquoi cela doit-il se passer dans l’ici-bas ?
Jésus-Christ a montré l’exemple : il est venu sur cette terre pour apporter le salut. Celui-ci a une validité universelle et concerne donc l’ici-bas et l’au-delà. Il est ainsi écrit dans le Catéchisme : « Comme Jésus-Christ a consenti son sacrifice ici-bas, c’est aussi sur la terre que les apôtres communiquent le salut. Étant donné que les sacrements ont toujours un aspect visible, ils ne peuvent être administrés que dans le domaine des choses visibles. » (CÉNA 9.6.3).
Pourquoi fallait-il des représentants ?
Le principe de la procuration est également désigné comme la loi structurelle de l’histoire biblique salvifique. L’exemple type est le Cantique du Serviteur en Esaïe, où le juste prend la défense du coupable et porte en conséquence le péché de ce dernier. Ce principe est vécu de manière très différente selon les confessions : une fois, un pasteur consacré endosse le rôle en lieu et place de Jésus-Christ lors de la sainte cène ; et une autre fois, lors du baptême, les parents ou les parrains et marraines confessent leur foi en le Sauveur par procuration. Et les chrétiens néo-apostoliques confessent leur foi dans le fait que le principe de la procuration sert autant les morts que les vivants.
Cette pratique n’est-elle pas isolée parmi les chrétiens ?
Les autres confessions connaissent également la commémoration des morts et l’intercession dans le contexte sacramentel de la célébration de la sainte cène. Ainsi, les « célébrations eucharistiques avec commémoration des morts » ont une place fixe dans le calendrier des paroisses catholiques. Et l’orthodoxie attribue une force particulière aux intercessions lorsqu’elles ont lieu dans le cadre de la « Divine Liturgie ». On y extrait également quelques petits morceaux au nom des défunts lors de la préparation du pain de la sainte cène.
Et le célèbre théologien protestant Dietrich Bonhoeffer évoque le baptême par procuration dans son expertise « Zur Tauffrage » (« Au sujet du baptême », NdT) datant de 1942 : « Pourquoi une telle conception du baptême ne pourrait-elle pas donner naissance à une telle coutume, expression extrême […] de la puissance du sacrement ? »
Photo: christianchan – stock.adobe.com