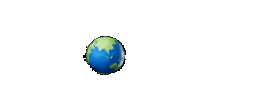1700 ans du concile de Nicée – Rappel historique

La Trinité divine – une évidence pour les chrétiens aujourd’hui. Mais cela a été contesté à une certaine époque. Le concile de Nicée, qui s’est tenu il y a 1700 ans, a permis de clarifier la situation : voici le début de la série d’articles qui seront consacrés à cet anniversaire.
Les communautés chrétiennes ont été persécutées plus ou moins intensément par les autorités romaines pendant près de trois siècles. Les chrétiens ont été tués, dénoncés et désavantagés dans la société en raison de leur foi.
La situation a changé avec l’empereur Constantin, qui a régné de 306 à 337 après J.-C. et qui a proclamé la liberté religieuse en 313. Dans les années qui ont suivi, le christianisme n’a pas seulement été toléré, il a même été privilégié par rapport à d’autres religions et massivement encouragé. Constantin voyait en l’Église chrétienne un facteur de pouvoir évident.
En ce sens, l’empereur, qui n’était pas chrétien et qui s’est fait baptiser peu avant sa mort, avait intérêt à ce que l’Église chrétienne reste un facteur fiable au sein de l’Empire. Il a donc suivi avec intérêt l’évolution de la communauté chrétienne, dont la popularité et l’attrait augmentaient en raison de la tolérance qui lui était accordée et, finalement, du privilège. C’est là que des choses déterminantes se sont passées.
Sur la piste du mystère
Au début du troisième siècle de notre ère, le débat théologique s’était intensifié sur la question de savoir si le Père et le Fils étaient vrai Dieu de manière égale. La controverse pour savoir si le Fils est créature ou éternel d’égale manière avec le Père semblait mettre en danger l’unité de l’Église chrétienne au sein de l’Empire romain.
Dans le Nouveau Testament, il existe de nombreuses déclarations sur la nature et l’œuvre de Jésus qui soulignent sa divinité et font référence aux aspects divins de son action et de sa nature. Toutefois, il n’existe aucune explication supplémentaire. Et c’est ainsi qu’au cours des siècles suivants, on s’est vu contraint de réfléchir à ce problème sur le plan théologique et de le saisir de manière doctrinale.
Les deux concepts probablement les plus importants qui ont tenté de clarifier le mystère de Dieu – c’est-à-dire du Père, du Fils et du Saint-Esprit – sont le subordinatianisme et le modalisme.
Créateur et créatures
Le subordinatianisme défend la position selon laquelle le Logos (ou le Fils) est une créature de Dieu dont la nature est similaire, mais non pas identique à celle de Dieu le Père. On pensait que le Fils et aussi le Saint-Esprit avaient été créés par Dieu avant tous les temps. Par conséquent, ils sont secondaires ou subordonnés au vrai Dieu.
C’est cette position qui avait le plus de partisans au deuxième et au début du troisième siècle. Cependant : le subordinatianisme risque de relativiser le monothéisme et d’attribuer à Dieu le Père des divinités secondaires ou subordonnées.
Les facettes d’une unité
Le modalisme (de modalité = manière, possibilité) défend l’idée que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que de simples manifestations ou révélations du Dieu unique, alors que Dieu est un en soi. En conséquence, dans l’histoire du salut, Dieu peut être expérimenté comme Père, puis comme Fils et comme Saint-Esprit, alors qu’en son for intérieur, il est toujours un.
Le modalisme s’efforce de mettre en évidence l’unité intérieure de Dieu afin d’éviter que la foi en un Dieu unique ne soit relativisée. Toutefois, le danger existe que l’incarnation de Dieu en Jésus-Christ ne se produise qu’en apparence et ne possède en soi aucun caractère réel.
Il faudra attendre le concile de Nicée pour savoir quelle vision théologique s’imposera. Ce sera l’objet de la prochaine partie de cette série.
Contexte : Ce que dit la Bible sur la Trinité
Le Nouveau Testament témoigne de la divinité du Fils. Ainsi, il est dit du Logos (la Parole divine) qu’en Jésus, Dieu s’est fait homme : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » (Jean 1 : 1). La désignation de Dieu pour le Logos incarné se retrouve à plusieurs reprises dans l’évangile selon Jean (Jean 1 : 17 ; 20 : 28). Dans le Nouveau Testament, il est également précisé que le Fils de Dieu était auprès de Dieu – donc préexistant – avant son incarnation. En Philippiens 2 : 6, il est question de Jésus-Christ en tant que « forme de Dieu » dans le ciel (Philippiens 2 : 6-7), qui s’est fait homme et s’est ainsi abaissé.
La référence la plus fréquente et la plus appuyée à la divinité de Jésus-Christ est le terme « Kyrios » (Seigneur). Dans la Septante, la traduction pré-chrétienne des écrits de l’Ancienne Alliance en grec, « Kyrios » sert à désigner Dieu. Dans les écrits néo-testamentaires, ce terme est également appliqué à Jésus (Matthieu 9 : 28 et Luc 5 : 8, par exemple). En Actes 10 : 36b, Jésus est désigné comme « Seigneur de tous » ; et Paul souligne – et cela peut déjà être lu comme une référence à l’unité des Personnes divines : « Et que personne ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n’est par le Saint-Esprit. » (I Corinthiens 12 : 3b).
Alors que dans l’Ancien Testament, l’Esprit de Dieu est compris comme une force vitale divine, le Nouveau Testament parle du Saint-Esprit en termes de Personne. Dans l’évangile selon Jean, c’est le Saint-Esprit qui rappelle aux disciples et à l’Église les paroles et les actes de Jésus (Jean 14 : 26). Le Saint-Esprit est l’« autre consolateur », celui qui représente Jésus dans le temps de l’Église et qui donne la connaissance, comme Jésus l’a fait (Jean 14 : 16). Il est également question du fait que le Saint-Esprit « enseigne » (Luc 12 : 12), parle et ordonne (Actes 13 : 2), institue des évêques (Actes 20 : 28) ou donne des mandats missionnaires (Actes 8 : 29). De plus, l’Esprit Saint enseigne la bonne manière de prier (Romains 8 : 26). L’union absolue de Dieu et de l’Esprit est évoquée en I Corinthiens 2 : 11, et en II Corinthiens 3 : 17, l’Esprit – tout comme Jésus-Christ – est appelé « Seigneur ». Sa divinité et sa personnalité sont ainsi soulignées.
Lors du baptême de Jésus, le Père et le Saint-Esprit se manifestent. Le Père confesse son Fils et le Saint-Esprit est le compagnon permanent de l’homme qu’est Jésus. De même, le lien étroit entre Jésus-Christ et le Paraclet – c’est-à-dire le Sauveur et le Consolateur – qui rend présent dans l’Église le Seigneur élevé et monté au ciel, peut être compris comme une référence au mystère de la Trinité : le Fils et l’Esprit sont un avec le Père, de sorte que la parole et la volonté du Père sont en même temps la parole et la volonté du Fils et de l’Esprit (Jean 16 : 13-15).
De plus, les déclarations tripartites en I Corinthiens 12 : 4-6 ou la formule de bénédiction en II Corinthiens 13 : 13 peuvent être comprises comme des références importantes à la Trinité de Dieu.
Photo : Hyejin Kang – stock.adobe.com